Suite à mon premier article sur la décroissance, j’ai reçu quelques réactions qui soulignaient, à raison, que je ne définissais pas ce dont les théoricien·ne·s de la décroissance envisageaient de se défaire : la croissance.
Une clarification s’impose ici.
La plupart des sociétés humaines semblent vouer une certaine admiration – justifiée – à la croissance organique : un être humain qui grandit, une plante qui sort de terre, etc. On ne parle pas de cette croissance-là, qui elle s’inscrit dans un cycle très clair : naissance – croissance – déclin – mort.

La croissance à laquelle s’attaque la décroissance, c’est le principe à la base de l’économie capitaliste contemporaine, et qui influence par extension de nombreuses dimensions de notre existence.
Cette croissance-là est envisagée comme infinie et illimitée et c’est l’objectif et le moteur de l’économie actuelle. C’est celle-là qui est enseignée dans les amphithéâtres remplis d’économistes en devenir.
Au fondement de l’économie contemporaine, il y a en effet l’idée qu’il faut faire croître, d’une année à l’autre le PIB. Cela donne lieu à des communiqués de presse comme celui-ci, qui émane du Secrétariat d’État à l’économie suisse :

Quand on le lit, on a l’impression que c’est une bonne nouvelle… sans trop comprendre, pour la plupart d’entre nous, les mécanismes de cette croissance, ni les origines ou la définition précise de ce fameux PIB.
Après m’y être intéressée de plus près ces dernières semaines et tout en affirmant mon statut d’ignare en économie, voilà comment on peut, il me semble, mieux comprendre ce mécanisme :
Le Produit Intérieur Brut, ou PIB, est un indicateur qui a été inventé initialement dans les années 1930 aux États-Unis au sortir de la Grande Dépression. Le but était de créer un « baromètre » économique global dans le but d’évaluer la reprise économique et l’impact des politiques mises en place. Il a ensuite été progressivement adopté – et adapté – pour mesurer et refléter la « santé » économique des pays.
C’est un indicateur qui mesure la valeur monétaire des biens et des services produits dans un pays en une année.
Concrètement, il s’agit de calculer la valeur ajoutée aux biens et services produits. La valeur ajoutée correspond à la valeur finale à laquelle on déduit les consommations intermédiaires, c’est-à-dire ce qui a été dépensé pour le production. Si pour produire 1kg de pâtes vendu à 5€, on utilise 2€ de matières premières (œufs, farine, sel,…) et 1€ d’électricité, alors la valeur ajoutée et de 2€.
Et donc, pour calculer le PIB, on additionne toutes les valeurs ajoutées des biens et services produits dans un pays en une année.
Ça c’est la version simplifiée car dans les faits, le calcul est assez compliqué, et je vous laisse vous balader un peu sur le net ou questionner vos ami·e·s économistes si vous souhaitez comprendre dans les détails comment chaque élément est calculé.
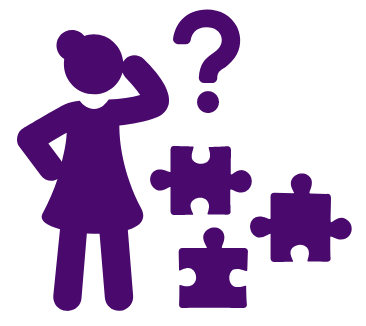
Plusieurs problèmes se posent assez rapidement quand on s’arrête sur cet indicateur :
- Premièrement, le fait qu’il mesure indifféremment les biens et les services produits quel que soit le contexte ou la finalité : si le pays connaît un nombre record d’accidents de la route, Bingo, le PIB augmente grâce aux frais d’ambulances, de soins hospitaliers, aux ventes de nouvelles voitures, etc.
- Deuxièmement, l’indicateur se limite aux biens et services qui ont une valeur monétaire, donc il ne mesure ni la richesse et la diversité de l’offre culturelle, ni le travail ménager et éducatif, ni les réseaux de solidarités ou l’engagement bénévole.
- Troisièmement, le PIB ne prend pas en compte les impacts écologiques des biens et services comptabilisés. Au contraire, malgré quelques théories qui essayent régulièrement de prouver le contraire, plus le PIB d’un pays augmente, plus l’impact écologique de ce pays, sur son territoire et/ou hors de son territoire, augmente.
En résumé donc, le PIB mesure la valeur monétaire des biens et services produits mais ne dit rien de la qualité de vie des habitant·e·s ni de l’impact des activités économiques sur la société et l’environnement.
Il y a heureusement d’autres indicateurs qui ont été développés pour mesurer ces choses-là et qui sont de plus en plus utilisés (la Nouvelle Zélande, l’Islande et l’Ecosse ont d’ailleurs fait le pas de se défaire de cet indicateur hégémonique pour développer ce qu’elles nomment – oui ce sont toutes des femmes qui gouvernent dans ces pays – une économie du bien-être).
Malgré la multiplication des critiques sur cet indicateur et les quelques alternatives qui se dessinent, il reste la boussole de la plupart des gouvernements et va bien au-delà d’un simple indicateur économique.
Car ce n’est pas seulement un chiffre qui permet aux dirigeant·e·s d’évaluer la capacité de leur pays à produire toujours plus, c’est aussi un moyen de comparer leur croissance par rapport aux autres pays. Dans ce sens, le PIB est un enjeu de pouvoir sur la scène internationale.
Le G20 par exemple, réunit les dirigeant·e·s des pays les plus riches (donc ceux qui ont le plus haut PIB)… À l’occasion de cette petite fête privée, ces gouvernements ont donc le pouvoir d’orienter les choix politiques et économiques mondiaux. Il y a dès lors un réel enjeu pour les dirigeant·e·s de ces pays à maintenir leur PIB dans le top 20 (sur près de 200 pays actuellement reconnu par l’ONU).

Avec quelques uns de leurs amis en 2018 à Buenos Aires
© Par G20 Argentina — Family photo of the G20 Summit, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74828206
Le G7 qui s’est récemment réuni autour de Boris Johnson, c’est la version select du G20. Ils se définissent d’ailleurs assez clairement comme : « the only forum where the world’s most influential and open societies and advanced economies are brought together for close-knit discussions »

(source : site officiel du G7)
Le G7 réunit le Royaume-Uni, les USA, le Canada, le Japon, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Union Européenne
et peuvent inviter d’autres pays à participer aux discussions.
Le PIB, c’est donc un indicateur économique central qui ne sert pas seulement à évaluer la « santé » de l’économie d’un pays. Il définit également quels gouvernements ont le droit de mener des discussions serrées (je ne crois pas que « close-knit » signifie ici qu’ils discutent tricots…) car ils représentent « les sociétés les plus influentes et ouvertes et les économies les plus avancées ».
Donc en résumé, la croissance, c’est l’augmentation du PIB d’une année à l’autre, ce qui implique de produire toujours plus pour créer de la valeur monétaire, et cet indicateur définit également le poids des différents gouvernements dans une partie des discussions politiques internationales

Au-delà de ces dimensions économique et politique, les théoricien·ne·s de la décroissance ont aussi mis en avant que le principe de la croissance va bien au-delà du PIB. Il n’y a pas que nos dirigeant·e·s qui courent après la croissance, l’entier de la société, ou presque, a intégré cette quête comme fondamentale et légitime.
Certain·e·s auteur·e·s décrivent la croissance comme une idéologie.
En érigeant l’équation « augmentation quantitative » = « progrès » comme une évidence, la logique de la croissance économique s’est échappé du tableau excel des économistes pour coloniser notre imaginaire collectif et individuel.
C’est vrai pour les entreprises, qui d’une année à l’autre ont pour objectifs d’augmenter leur bénéfice, leurs parts de marché, leurs ventes, etc.
C’est aussi le cas de la plupart des individus. La trajectoire de vie normale implique une augmentation du revenu, des possibilités et des possessions matérielles.
La caricature de cette norme sociale, c’est Jacques Séguéla, publicitaire français et proche de Nicolas Sarkozy, qui annonce « Si à 50 ans on n’a pas une Rolex, c’est qu’on a quand même raté sa vie ». Même si l’exemple fait sourire et ne correspond pas à ce que la plupart d’entre nous considère comme une vie réussie… personne n’imagine, avoir le même revenu toute sa vie, ou un revenu qui diminuerait linéairement avec l’âge.
Mais au-delà du salaire, la croissance en tant que norme sociale incorporée c’est aussi le désir d’avoir plus d’amis sur Facebook, enchaîner les formations continues pour avoir plus d’opportunités professionnelles, développer ses loisirs, découvrir chaque année de nouvelles destinations de vacances, etc.
Si se défaire de la croissance en tant qu’idéal de société semble a priori assez facile : « développons d’autres indicateurs de progrès et abandonnons cette idée de PIB ».
Dans les faits, les ramifications de cette idéologie incorporée par les gouvernements, les institutions, les entreprises et les individus rendent la tâche un peu plus complexe… d’où l’intérêt d’aller voir les idées de celles et ceux qui travaillent sur la décroissance depuis plusieurs années.
Suite au prochain épisode…
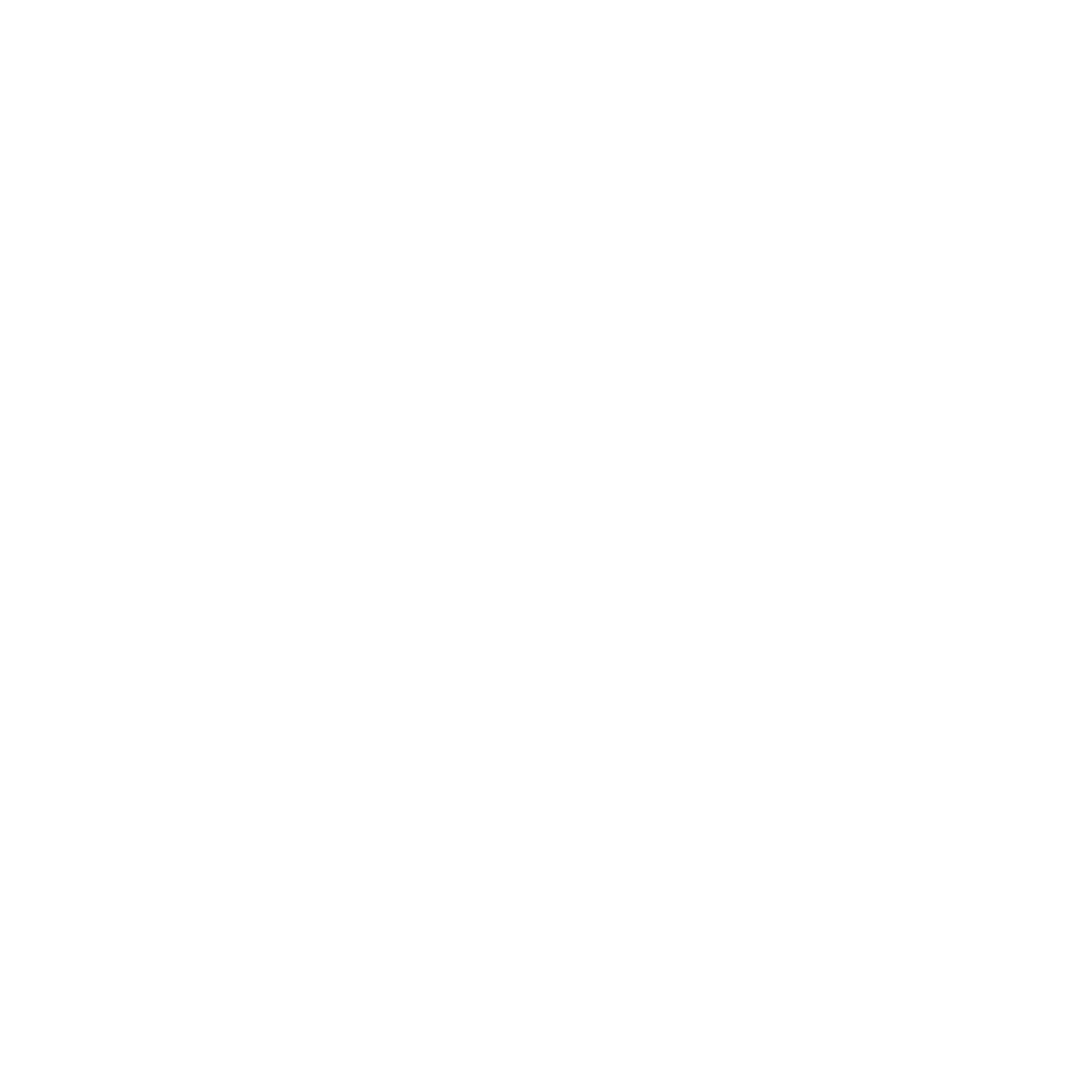
Commentaires récents